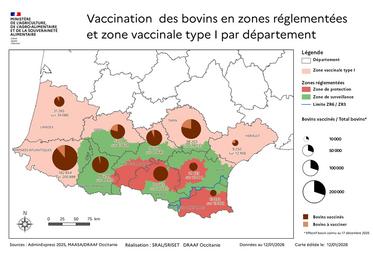Main d'oeuvre
Emploi saisonnier : ce qu'il est utile de savoir
Alors que les récoltes et moissons sont achevées et que la cueillette de pommes et les vendanges arrivent très vite, les entreprises agricoles ont ou auront recours à l’embauche.
Alors que les récoltes et moissons sont achevées et que la cueillette de pommes et les vendanges arrivent très vite, les entreprises agricoles ont ou auront recours à l’embauche.

Alors que l’été bat son plein, le recours à la main d'œuvre saisonnière devient une nécessité pour de nombreuses exploitations agricoles. Face à cette demande croissante, les modalités de recrutement, les obligations réglementaires et les conditions de travail, notamment en période de fortes chaleurs, doivent être connues et respectées. Loin d’être un simple appoint temporaire, l’emploi saisonnier s’inscrit dans un cadre légal précis, dont les agriculteurs doivent pleinement maîtriser les contours pour garantir un travail sécurisé et conforme aux exigences en vigueur.
Travail saisonnier : motif légal de recours au CDD
Le contrat à durée déterminée (CDD) est la forme contractuelle adaptée pour l’embauche d’un travailleur saisonnier. En effet, le travail saisonnier constitue un motif légal de recours au CDD, car il correspond à des tâches appelées à se répéter chaque année à des périodes à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des cycles de production agricole. Dans ce cadre, le CDD saisonnier permet de répondre à un besoin temporaire de main-d’œuvre sans entrer dans la logique du contrat à durée indéterminée (CDI). Pour être conforme à la législation, le contrat doit impérativement être écrit et mentionner explicitement le caractère saisonnier de l’emploi, la date de début, la durée (ou la durée minimale si la fin ne peut être précisément définie), ainsi que la nature des tâches confiées. Ce cadre permet à l’employeur de faire face à un besoin temporaire tout en respectant la réglementation du travail, et il offre au salarié un cadre clair et sécurisé quant à son emploi et ses droits.
La Tesa : outil administratif de simplification
Le TESA, ou Titre emploi simplifié agricole, est un dispositif mis en place par la MSA (Mutualité sociale agricole) pour faciliter les démarches administratives liées à l’embauche de salariés dans le secteur agricole. Il s'agit d’un outil de simplification, destiné aux employeurs agricoles, leur permettant de gérer en une seule déclaration plusieurs formalités : la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), l’établissement du contrat de travail, la déclaration des cotisations sociales, ainsi que l’édition des bulletins de paie. Cependant, il ne constitue pas un contrat de travail en soi. Cette confusion est fréquente : certains employeurs pensent à tort qu’utiliser le TESA revient à signer un contrat saisonnier, ce qui est inexact. Le TESA peut être utilisé pour embaucher des salariés temporaires, qu’ils soient saisonniers ou non. Inversement, un contrat saisonnier n’oblige pas l’employeur à passer par le TESA ; il peut très bien utiliser d’autres moyens de gestion administrative. Il est également important de noter que l’utilisation du TESA n’exonère pas l’employeur de ses autres obligations légales, comme l’adhésion aux organismes de complémentaire santé et de prévoyance, ou encore la demande de visite d’information et de prévention (visite médicale d’embauche) si elle est requise. En résumé, le TESA est un outil administratif de simplification, mais ne remplace en aucun cas les obligations légales ni ne définit la nature du contrat de travail.
L'embauche d'un jeune de moins de 18 ans
Chaque été, de nombreux jeunes mineurs rejoignent les exploitations agricoles pour prêter mainforte pendant les récoltes. D’abord, l’employeur doit impérativement recueillir une autorisation écrite des parents, établir un contrat de travail, puis prévenir l’inspection du travail. Pour les 14-16 ans, une autorisation formelle doit être envoyée au moins 15 jours avant l’embauche. Pour les 16-18 ans, une simple déclaration préalable est requise. Il est possible pour les jeunes âgés entre 14 et 16 ans d’être embauchés lors des vacances scolaires à la condition que celles-ci durent au moins 7 jours et que la durée du contrat ne soit pas supérieure à la moitié de la durée totale des vacances. La durée du travail varie selon l’âge : 32 heures hebdomadaires maximum pour les 14-15 ans, 35 heures pour les plus âgés. La journée ne peut excéder 7 heures pour les moins de 16 ans, et 8 heures pour les 16-18 ans. Des temps de repos sont également imposés : au moins 14 heures consécutives pour les plus jeunes, 12 heures pour les autres, ainsi qu’une pause de 30 minutes toutes les 4h30 de travail. Le repos hebdomadaire doit inclure obligatoirement le dimanche pour les moins de 16 ans, et au moins deux dimanches par mois pour les autres. Le travail de nuit est totalement interdit : de 20h à 6h pour les moins de 16 ans, de 22h à 6h pour les 16-18 ans. De plus, les mineurs ne peuvent pas être affectés à des tâches dangereuses comme la conduite d’engins agricoles de plus de 2,5 mètres de large sur route, l’utilisation de produits chimiques, les travaux en hauteur ou en milieux confinés, ou encore les tâches exigeant une force physique excessive. Des limites de port de charges s’appliquent : pas plus de 15 kg (8 kg pour les filles) pour les 14-15 ans, et 20 kg (10 kg pour les filles) pour les 16-17 ans. Une visite médicale d’embauche est obligatoire, même pour un contrat court, et les jeunes doivent bénéficier d’un encadrement renforcé en cas de fortes chaleurs : eau fraîche à disposition, horaires aménagés, pauses régulières, et équipements de protection adaptés. Enfin, l’employeur doit ajuster le document unique d’évaluation des risques (DUERP) et garantir des conditions de travail sûres sur toute la durée du contrat. S’agissant de la rémunération des jeunes, elle doit être au moins égale au SMIC minorée de 20% pour les jeunes de moins de 17 ans et 10% pour les jeunes entre 17 et 18 ans. Cependant, cet abattement ne vient pas à s’appliquer si le jeune saisonnier justifie d’au moins 6 mois d’ancienneté. Ces règles, bien que strictes, sont essentielles pour que l’expérience du travail saisonnier reste formatrice et sécurisée pour les plus jeunes.
Comment faire face aux vagues de chaleur ?
Avec la recrudescence des vagues de chaleur, la protection des travailleurs saisonniers agricoles devient une priorité sanitaire et légale. En vertu de l’obligation générale de sécurité inscrite dans le Code du travail, l’employeur agricole doit impérativement évaluer les risques liés à l’exposition à la chaleur, notamment à travers la mise à jour du Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Cette évaluation est obligatoire, y compris pour les petites exploitations, et doit déboucher sur des mesures concrètes de prévention. Parmi ces mesures figurent en premier lieu l’organisation du travail : horaires décalés pour éviter les pics de chaleur, augmentation de la fréquence des pauses, réduction de la charge physique. Les chantiers doivent être aménagés de façon à permettre des moments de repos à l’ombre, dans un lieu ventilé, ou à défaut dans un local adapté. L’accès à au moins 3 litres d’eau potable et fraîche par jour et par salarié est obligatoire, tout comme la mise à disposition de moyens de rafraîchissement et de protection contre le soleil, comme des chapeaux, vêtements respirants, et abris. En parallèle, l’information des salariés est une obligation légale. Ils doivent être sensibilisés aux risques de coup de chaleur (fatigue, maux de tête, crampes, nausées, vertiges), ainsi qu’aux gestes à adopter pour se protéger. Cette sensibilisation doit figurer dans le DUERP, mais aussi se matérialiser sur le terrain par de l’affichage ou des rappels quotidiens. L’employeur doit également fournir des Équipements de protection individuelle (EPI) adaptés. Depuis le décret du 27 mai 2025, ceux-ci doivent être vérifiés pour assurer leur efficacité quelles que soient les conditions climatiques. Si une variation de température ou d’humidité rend les EPI inadaptés, des équipements supplémentaires doivent être fournis. Il s’agit là d’une obligation impérative. Une attention renforcée est requise pour les salariés mineurs, considérés comme un public vulnérable. Les jeunes de moins de 18 ans doivent bénéficier de pauses plus régulières, d’un encadrement spécifique, et de postes de travail réévalués pour garantir leur sécurité en période de chaleur extrême. En cas de non-respect de ces règles, l’employeur s’expose à des sanctions administratives, mais aussi à une mise en cause de sa responsabilité pénale en cas d’accident lié à la chaleur. La prévention du risque thermique n’est donc pas une option : elle est une obligation réglementaire, humaine et morale.